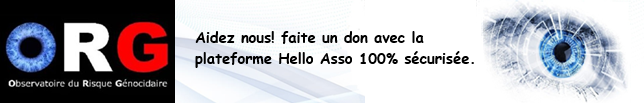Les civilisations meurent d’une lente érosion lorsqu’elles ne savent plus relever les défis du présent.
La fin de l’été de l’an 476 marque un tournant majeur dans l’Histoire de l’Occident. Le 4 septembre, un chef barbare nommé Odoacre met fin à un empire millénaire en déposant l’empereur romain d’Occident, le jeune Romulus Augustule. L’Empire romain d’occident qui se croyait éternel disparaît. Les correspondances avec notre temps sont nombreuses.
Un empire politiquement instable
Depuis le IIIe siècle, l’Occident romain est en effet affaibli par une instabilité politique permanente. Entre 235 et 284, l’Empire connaît ainsi plus de cinquante empereurs et usurpateurs, la plupart acclamés par leurs légions avant d’être assassinés. Cette succession effrénée de dirigeants mine la cohésion de l’État, réduit l’autorité impériale et affaiblit sa capacité à organiser sa défense. Les rivalités de pouvoir deviennent si fréquentes que l’unité romaine se fissure peu à peu.
En 475, Oreste, un Romain d’origine germanique ayant longtemps servi comme officier, profite ainsi de sa position de chef militaire pour renverser l’empereur Julius Nepos. Cependant, n’ayant ni légitimité dynastique ni prestige suffisant, il ne se proclame pas empereur. Il préfère placer son fils Romulus sur le trône, offrant à Rome un empereur de quatorze ans qui n’est, en réalité, qu’un paravent de son autorité.
Les invasions barbares
En parallèle, les frontières de l’Empire subissent une pression croissante. Dès 406, des populations entières franchissent le Rhin gelé et pénètrent en masse dans l’Empire. Plutôt que de les combattre systématiquement, Rome essaie de conclure des foedus, c’est-à-dire des traités instaurés dès le IIIe siècle permettant aux barbares de s’installer à l’intérieur des frontières de l’Empire en échange de leur aide militaire. Rapidement, cette politique ne suffit plus à contenir les flux migratoires et à contenter les peuples fédérés.
Devenu maître officieux de l’Occident, Oreste refuse, en 476, d’accorder des terres aux Hérules menés par Odoacre. Ce dernier, mécontent, prend alors les armes, bat les troupes romaines à Pavie, fait exécuter Oreste puis marche sur Ravenne où s’est réfugié Romulus. Sans armée pour le défendre, abandonné par ses conseillers, le jeune empereur se retrouve seul face au chef barbare. Acculé, il est contrant d’abdiquer le 4 septembre 476, abandonnant une couronne qu’il n’avait jamais vraiment portée.
Conséquences et héritages
La déposition de Romulus Augustule consacre la fin officielle de l’Empire d’Occident. Odoacre, respectueux des formes, renvoie les insignes impériaux à l’empereur d’Orient, Zénon, pour signifier que l’Empire d’Occident n’existe plus et que l’heure du règne des barbares sur cette partie de l’Empire romain a commencé.
Ce basculement entraîne des conséquences profondes, à commencer par l’apparition d’une mosaïque de royaumes germaniques (les Wisigoths en Espagne, les Ostrogoths en Italie et les Francs au nord de la Gaule. L’économie romaine s’effondre, le commerce à longue distance décline, les villes se vident, la société redevient rurale et le niveau de vie chute brutalement : une véritable rupture avec le passé.
Cependant, l’héritage romain ne s’éteint pas complètement. L’Empire d’Orient, bientôt appelé byzantin, poursuivra la tradition impériale pendant près de mille ans. L’Église, quant à elle, devient le principal dépositaire de la mémoire de Rome en Occident. Depuis la Ville éternelle, la papauté perpétue le latin, le droit romain et une certaine idée de l’universalité.
Une leçon de l’Histoire
Longtemps sûre de sa pérennité, Rome, pourtant forte de mille ans d’Histoire, s’est écroulée sous la pression conjuguée de menaces extérieures et de fragilités internes. Les civilisations disparaissent rarement d’un coup ; elles meurent d’une lente érosion lorsqu’elles ne savent plus relever les défis du présent. L’Histoire est un éternel recommencement. Ceux qui n’apprennent pas des leçons du passé s’exposent à les revivre.
Source : Boulevard Voltaire